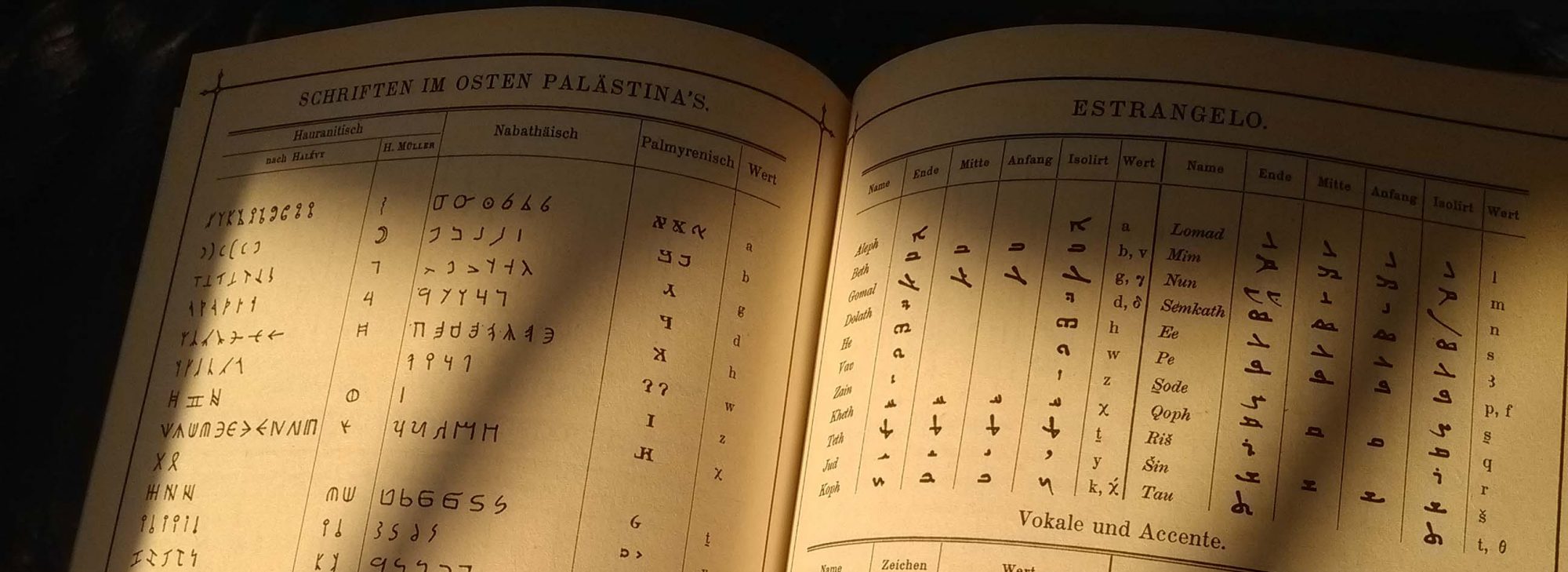tałi /ˈtaʟi/ n : 1. « petit X » ; 2. « Xeur »
Et voici un schéma de diminutif supplémentaire après -tiges (qui désigne aussi des noms des animaux immatures) et -ein (qui est aussi employé pour les petites quantités). Comparé aux deux autres, ses connotations sont assez neutres.
Mais ce n’est pas son seul sens. -li est également le suffixe des noms d’agent sur les racines verbales à voyelles longues, qui ne peuvent pas prendre -ai.
Pourquoi présenter ensemble ce qui semble n’être que deux suffixes homophones ? C’est que justement cette identité de son commence à brouiller la frontière entre les deux sens : les noms d’agents en -li acquièrent un sens diminutif (et on trouve donc le suffixe sur des verbes ayant déjà un dérivé en -ai, pas seulement ceux avec une voyelle longue).
Le suffixe « avale » les éventuelles consonnes finales du mot où il se place, sauf -k ‑g ‑ks avec lesquelles il fusionne en -łi, et les groupes se terminant par -t, sur lesquels sa forme est -ełi.
Mots dérivés (diminutif)
- appili /ˈapːili/ n.A (appi « miel »)
nectar - dīouli /ˈdiːuːli/ n.I (dīous « maîtrise »)
facilités, don - hankēptałi /ˈhankɛːptaʟi/ n.A (hankēptaks « massue »)
une espèce d’oignon de forme oblongue - padili /ˈpadili/ n.I (padi « feu »)
flamme - zonestiłi /zoˈnɛstiʟi/ n.E (zonestiks « ami »)
ami (proche)
Mots dérivés (agentif)
- kēptełi /ˈkɛːptɛʟi/ n.E (kēpt- « tuer »)
migraine, mal de crâne (représenté comme un animal se déplaçant dans la tête) - salōli /saˈloːli/ n.E (salō- « sécher »)
fiévreux, fébrile, malade