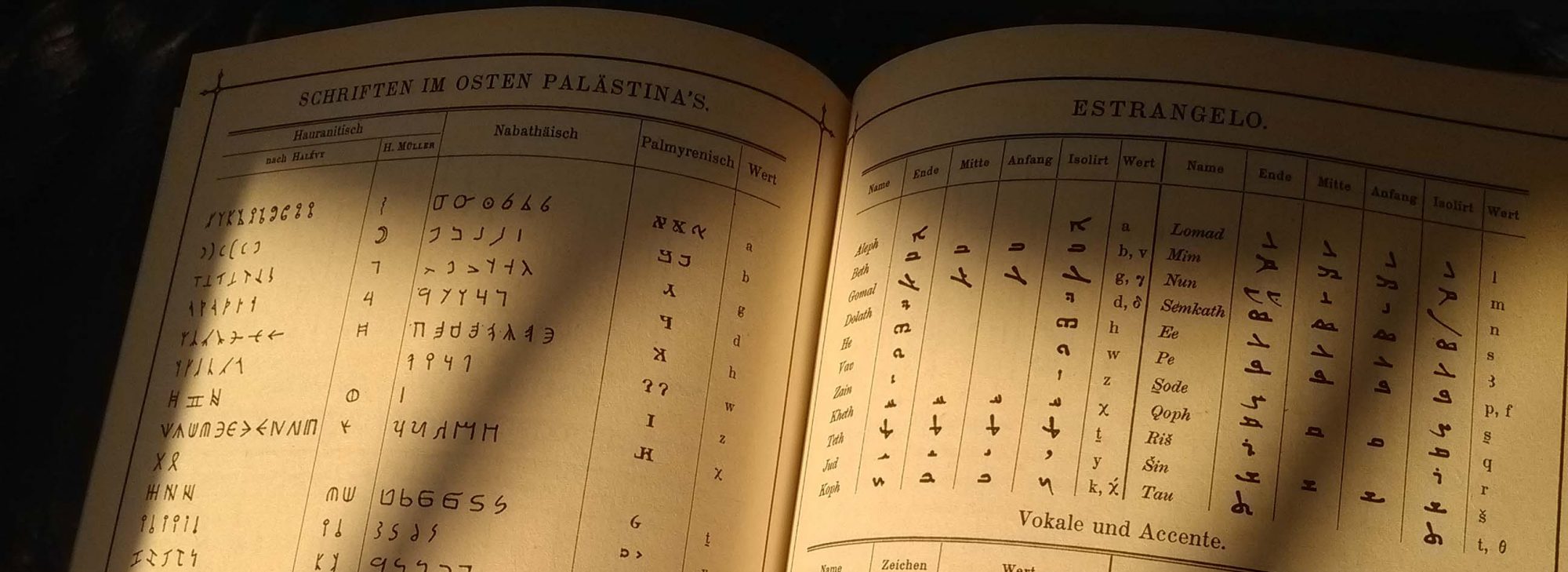kem /kem/, nom animé, pl. kemuor
- hache, cognée
- tête de hache
Un objet culturellement très important, d’où son genre animé.
Les haches de ce peuple sont formées de pierre taillée.
Exemples
- Biékiyuʔ-ʔe da sap ha totoxoy kememe ? « Ta hache a‑t-elle réduit la tête d’un chasseur en bouillie ? »
biek-◌́i-yu‑ʔ=ʔe
mâcher-
PASS.
SUBJ-
NEG-
3.
AN.
SG=
NEGsap
tête
ha
de
totoxoy
chasseur
- Otoʔ da kem mar bezek. « Elle prépare une grande tête de hache. »
uot-aʔ
sculpter-
PRS.
SUBJ.
3.
AN.
SGkem
hache
mar
sous
bezek
grande_chose
Concernant la formulation indirecte du premier exemple qui signifie en réalité « L’as-tu tué avec des coups de hache sur la tête ? » : il est évité de parler franchement de meurtre.
C’est tabou.
Ce n’est pas la personne qui a tué, c’est un outil qui lui appartient.
Comme ici cet outil est de genre animé, il accède à des verbes réservés à ce genre comme « manger, mâcher », pour une formule d’autant plus percutante.
Pour l’explication du second exemple : littéralement, on dit que la personne fabrique une hache à partir d’un grand objet (de l’ivoire, très certainement, étant donné le verbe).
Dérivés
- dakem, verbe : couper avec une hache (< da- « verbalisateur »)
- dakemey, nom animé, pl. dakemeyuor : porteur de hache (< -nay « nom d’agent »)
- dakemi, nom inanimé, pl. dakemi : coupe du bois (< -i « nominalisation »)
- dakemil, nom inanimé, pl. dakemili : entaille (< -il « nom de résultat »)
- ɣokemu, nom inanimé, pl. ɣokemuni : site de fabrication des haches, carrière (< ɣon‑u « qui engendre »)