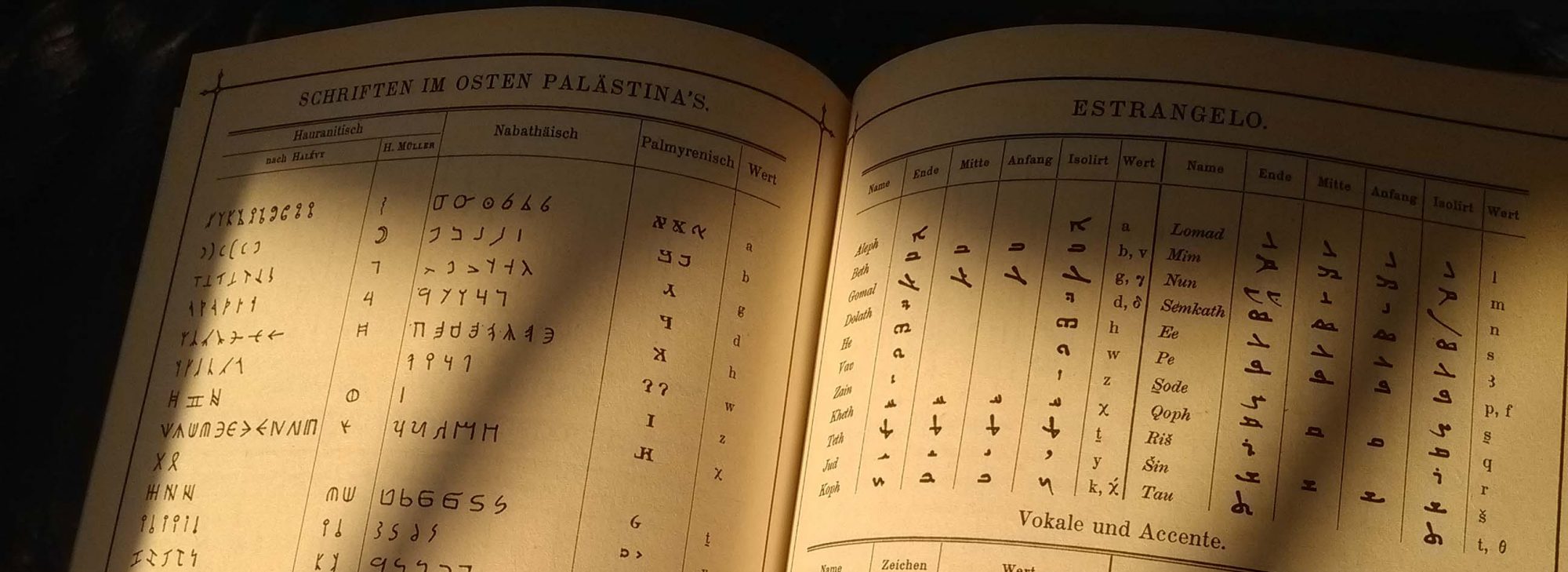bast- /bast-/, verbe
- claquer, frapper, taper (avec le plat de la main)
- frapper avec un objet plat
- claquer du bec (ciconiformes)
Pourquoi un tiret à ce mot ?
Pour signaler que cette racine ne peut pas apparaître sans un suffixe : deux consonnes ne peuvent pas terminer un mot.
Ce groupe -st, une fois qu’on lui ajoute le suffixe de voix moyenne -m, peut se simplifier de deux façons :
Il s’agit de variantes dialectales, et les langues filles du lamáya choisiront l’une ou l’autre.
Exemples
- Bastidat yaduk da manda. « Il claque le flanc du cheval. »
bast-id-at
claquer-
IND-
PRS.
OBJ.
3.
AN.
SGyaduk
cheval
manda
côtes
- Kabántuʔ. « Je me suis fait frappé, j’ai mal à la tête. »
ka-bast-m-◌́uʔ
AUG-claquer-
MED-
PASS.
SUBJ.
1.
SG
- Bástur bastayor kin kin. « Les cigognes claquaient du bec au loin. »
bast-◌́ur
claquer-
PASS.
SUBJ.
3.
AN.
PLkin
vers
kin
vers
La seconde phrase d’exemple n’est qu’un seul verbe, mais sa glose est volubile.
La combinaison de la voix moyenne (qui diminue l’agentivité du sujet) et de l’augment (qui attire l’attention de l’interlocuteur sur la situation) traduit l’ignorance de la locutrice quant à ce qui l’a frappée.
Ce que, et non pas qui : si ç’avait été un animé, on n’aurait pas employé le moyen, mais la troisième personne indéfinie.
Dérivés
- bastay, nom animé, pl. bastayuor : cigogne (< -nay « agent »)
- basti, nom inanimé, pl. basti : claque, tape (< -i « nom d’action »)
- bastil, nom inanimé, pl. bastili : claque, douleur de la claque (< -il « nom de résultat »)
- baṛsey, nom inanimé, pl. baṛseni : morceau de bois plat employé pour la production musicale (< -ṛey « nom d’outil »)