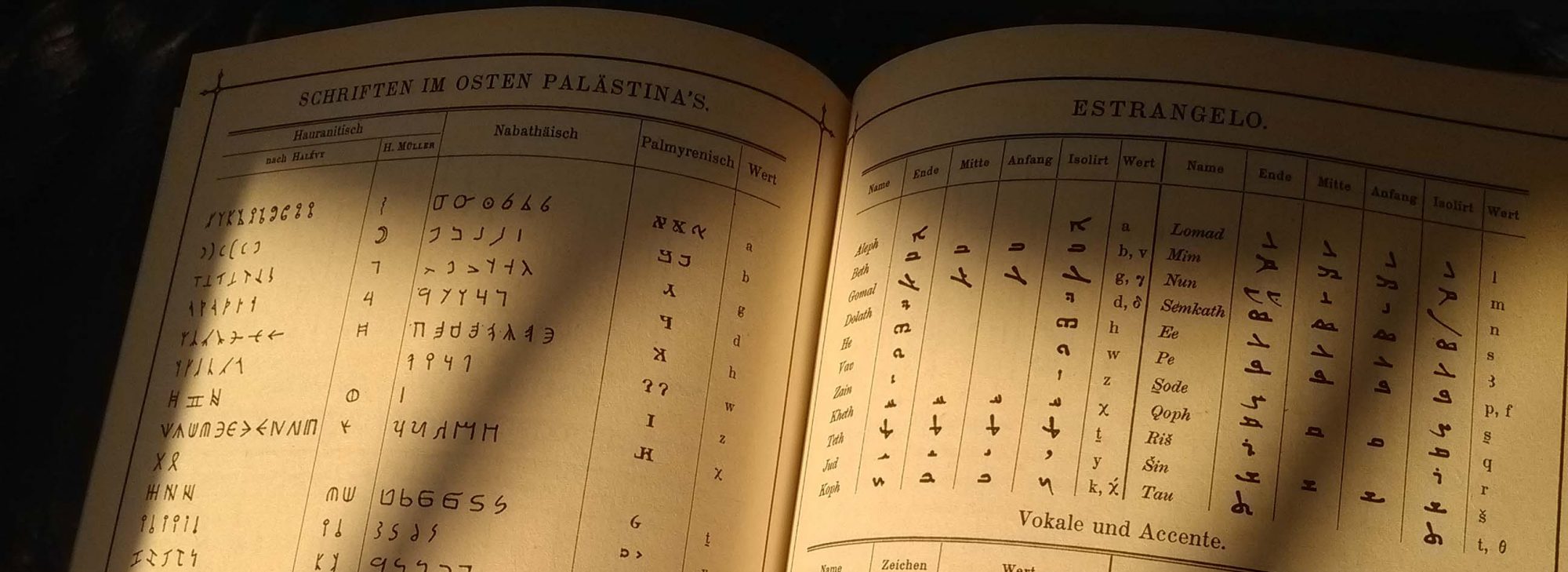tuɣaz /tuˈʁaz/, nom inanimé, pl. tuɣazi
- os
- aiguille
Exemples
- Bekuor tuɣaz eṛodor. « Les hyènes mangent les os. » biek-uor
manger-PRS.SUBJ.3.AN.PLtuɣaz
oseṛod-or
hyène-PL.NOM - Luoʔ da bezek, kieret tuɣaz mat man, wexetil mat buʔ. « Tu dis que ça, c’est une grande aiguille, mais ça me paraît être une sagaie. » luoʔ
voicida
ARTbezek
grande_chosekiere‑t
cette_chose_là-NOMtuɣaz
aiguillemat
avecman
2.SG.ABSwexetil
sagaiemat
avecbuʔ
1.SG.ABS
Dans la première phrase, l’objet est générique (ce ne sont pas des os en particulier), il n’y a donc pas d’article da.
Concernant le second exemple, une structure de phrase nominale (X est Y) est nuancée par la présence de deux perceptions contrastées ; littéralement la phrase signifie « voici une grande chose, c’est une aiguille chez toi (dans ta vision), c’est une sagaie chez moi ».
Dérivés
- čuɣaz, nom inanimé, pl. čuɣazi : arête, carcasse de poisson (< palatalisation « diminutif »)
- tuɣazaka, nom inanimé, pl. tuɣazika : squelette (< -aka « nom collectif »)