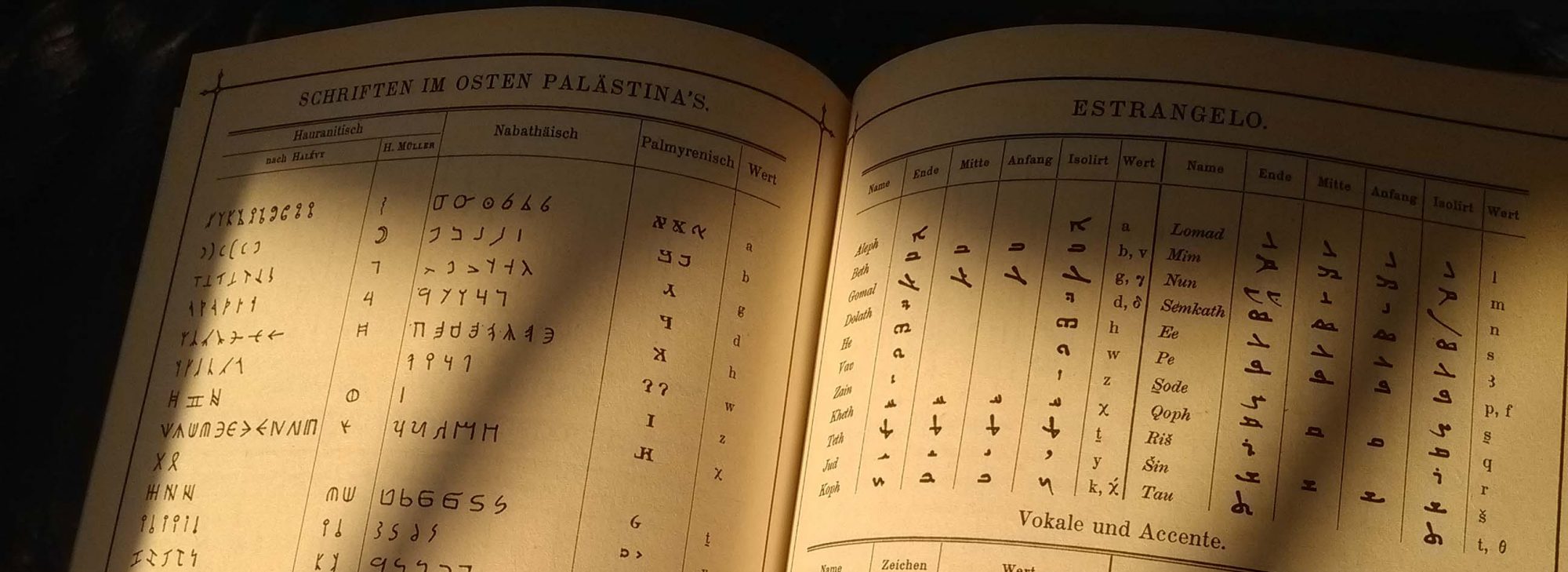Demain commence le Lexembre, un mois de création lexicale quotidienne dans une idéolangue de mon choix.
Qu’est-ce que le lamáya, qui détient cet honneur aujourd’hui ?
Je l’imagine parlée dans un environnement de savane, par des groupes de chasseurs-cueilleurs, juste avant la révolution néolithique.
Elle a pour but de servir de proto-langue pour une famille parlée dans un de mes univers, laquelle a pour objectif de rappeler les langues afro-asiatiques esthétiquement et conceptuellement.
Pour l’instant, j’imagine trois branches :
- La première, qui n’a pas forcément laissé de descendants à l’époque moderne, se sera diversifiée assez tôt, fournissant un substrat pour les autres branches
- La seconde aura pour principal représentant un équivalent de l’égyptien ancien mêlé d’akkadien, une langue classique qui reste un marqueur de culture pour les modernes
- La troisième, la plus importante jouera le même rôle que les langues sémitiques modernes, en particulier l’une d’entre elles qui sonnera hébreu/arabe
Prononciation
Il y a cinq voyelles a e i o u, et deux diphtongues ie uo.
Les vingt consonnes sont :
| labiales | apicales | rétroflexe | palatales | vélaires | labio-vélaire | glottales | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| occlusives | p b | t d | k g | ʔ | |||
| affriquée | č | ||||||
| fricatives | s z | x ɣ | h | ||||
| rhotiques | r | ṛ | |||||
| latérale | l | ||||||
| nasales | m | n | |||||
| semi-consonnes | y | w |
L’accent tonique se place régulièrement sur la dernière syllabe, mais peut reculer sur l’avant-dernière ou l’antépénultième des verbes dans certaines formes conjuguées ; également dans les noms pourvus de suffixes possessifs (comme le nom de la langue lamáya, littéralement « notre langue »).
Grammaire
L’ordre des mots dans la phrase est verbe-objet-sujet.
Noms
Les noms sont classés en deux genres, animé et inanimé.
Le premier regroupe animaux et humains, ainsi que certaines forces naturelles, le second tout le reste.
Ils sont fléchis pour le nombre (singulier, duel, pluriel) et le cas (nominatif, absolutif).
Un mot sur les cas : c’est l’absolutif qui est la forme de base, le nominatif marqué ne servant que comme sujet du verbe.
Ils peuvent également recevoir des suffixes indiquant la personne du possesseur (1ʳᵉ exclusive, 1ʳᵉ inclusive, 2ᵉ).
Verbes
Les verbes se conjuguent pour le temps (présent ou passé) ; la personne (1ʳᵉ exclusive, 1ʳᵉ inclusive, 2ᵉ, 3ᵉ), le nombre (singulier, pluriel) et le genre (animé, inanimé) du sujet ; pour la présence ou nom d’un objet animé ; pour la personne (1 exclusive, 1 inclusive, 2) de l’objet ; pour la voix moyenne (signalant que le sujet bénéficie de l’action) ou bénéfactive (signalant que c’est une tierce personne qui bénéficie de l’action) ; et enfin, pour la négation.
Je ne présenterai pas le tableau complet des flexions, si ça ne vous dérange pas.
Voyons simplement quelques exemples avec le verbe ɣaz- « laver » :
- Ɣazuoʔ da nikot. « Je lave le pot. » ɣaz-uoʔ
laver-1.SG.SUBJda
ARTnikot
pot - Ɣazoʔ da pieg. « Je lave le lion. » ɣaz-oʔ
laver-1.SG.OBJda
ARTpieg
lion - Ɣánzuʔ. « Je me lavais. » ɣaz-m-◌́ u‑ʔ
laver-MED-PST.SUBJ-1.SG - Ɣazidómo da nikot. « Je lave votre pot. » ɣaz-id-oʔ-ma
laver-IND-1.SG.OBJ-2.PATda
ARTnikot
pot