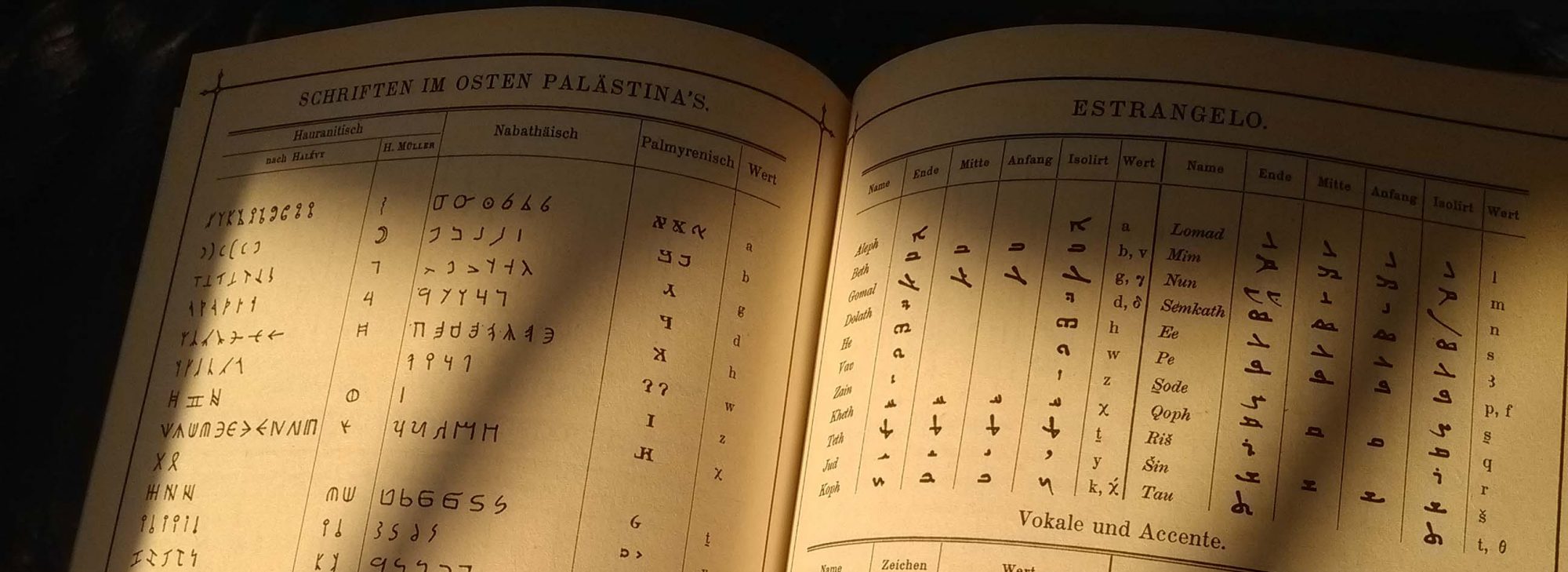Bienvenue à la troisième édition de Lexembre sur ce blog. Chaque jour pendant un mois, je vais créer un nouveau mot dans une de mes idéolangues (plus certains de ses dérivés) et digresser en quelques lignes sur un point de grammaire ou de culture.
... Non. Cette année, ce sera un peu différent. J'ai ressorti un vieux projet de roman pendant le mois de novembre pour lequel j'avais vaguement esquissé une langue, celle d'une société voyageant à travers les airs entre des îles isolées du reste du monde. La facilité des communications devait conduire à l'homogénéisation des parlers, et donc une seule langue.
En retravaillant le roman, je me suis rendu compte que la présence dans cette société d'une caste, interdite de vol, et ayant très peu de contact avec le reste de la population devait conduire à l'émergence de dialectes distincts, voire même de langues-sœurs. Je ne pouvais donc pas échapper à la création d'une famille entière.
Fort heureusement, le travail idéolinguistique est encore très peu avancé. Je peux recommencer depuis le début, c'est à dire dériver plusieurs langues-filles à partir d'une langue-mère unique en simulant le passage du temps. Cette méthode, que j'avais appelée pseudo-diachronique dans mon mémoire, est parfaite pour générer des irrégularités et des correspondances entre langues paraissant naturelles.
Ce Lexembre, je vais présenter une racine et ses descendants dans une poignée de langues. Leurs formes, mais aussi leurs sens pourront changer drastiquement. Comme la grammaire n'est pas encore très définie, ces racines seront surtout nominales et les mots obtenus serviront surtout à nommer des personnages et des lieux.
Les langues et leurs environnements
La langue-mère (ci-devant PI pour "proto-île") était parlée il y a un ou deux millénaires par un peuple de marins à un développement technologique et social comparable à celui des locuteurs du proto-polynésien.
La langue-fille principale (ci-devant F pour feui-naan) est employée par une société utilisant l'art (visuel et auditif) pour charmer des esprits. Grâce à ceux-ci, les gens sont capables de relier les îles par la voie des airs. La mer qui les entoure est taboue pour plusieurs raisons. De ce fait, ils vivent exclusivement dans les hauteurs.
Les autres dialectes sont désignés par le préfixe M (pour "maritime") suivi d'un numéro désignant une zone. Ce sont les parlers de la caste héréditaire des croque-morts, qui du fait de leurs activités sont restreints au bord de mer. Pour se déplacer d'île en île, ils ont conservé certaines des techniques de navigation de leurs ancêtres, mais les voyages sont moins fréquents que chez les locuteurs de F, et les innovations linguistiques sont parfois restreintes à quelques groupes d'îles, favorisant la fragmentation dialectale. Le stade intermédiaire entre PI et les dialectes actuels est appelé PM (pour "proto-maritime")
Modèle de présentation
*racine //, informations grammaticales, "sens"
- forme en F // "sens"
- forme en PM // "sens"
- forme en M1 // "sens"
- forme en M2 // "sens"
- etc.
Informations culturelles.