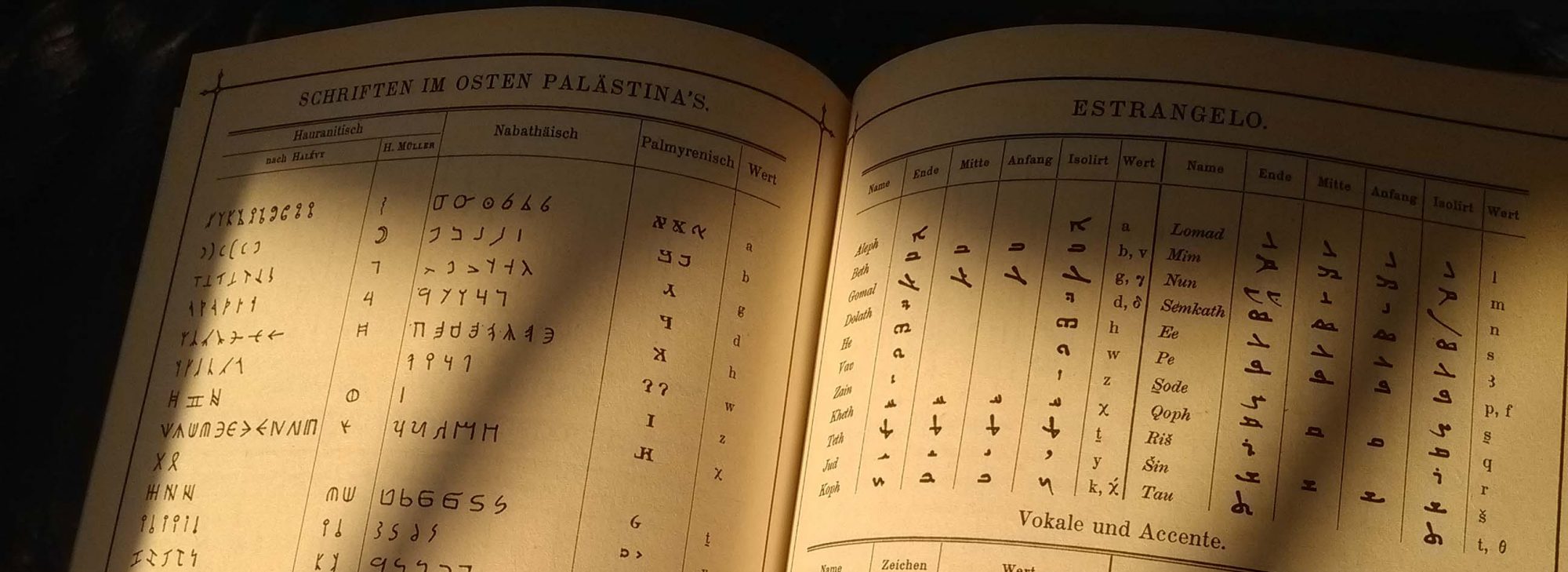tata /ˈtata/ n : forme hypocoristique de X
La forme de ce schéma applicable aux noms ne se laisse pas définir en une seule ligne. Il s’agit d’une simplification de la prononciation suivie d’une réduplication totale ou partielle du mot obtenu.
- Dans les groupes de consonnes, les moins sonores disparaissent en priorité. Par exemple, /ks/ devient /s/ et /sm/ devient /m/
- Presque toutes les consonnes géminées sont simplifiées
- Les voyelles et diphtongues longues raccourcissent
- Une voyelle initiale est élidée
- Si la réduplication met des consonnes en contact, l’une d’entre elle disparaît
Ces mots sont employés en priorité par et avec les très jeunes enfants, et ne changent pas vraiment le sens du mot de départ, seulement son contexte. Mais quelques-uns d’entre eux ont été lexicalisés.
Mots dérivés
Seuls les mots ayant un sens supplémentaire sont indiqués ici.
- damisamis // n.I (dampis « poil »)
barbichette - kilisilis /ˈkilisilis/ n.I (kilips « poisson »)
petites figurines d’argile en forme de poisson - lolon /loˈlon/ n.I (ilon « queue »)
zizi, petit pénis - soisoi /ˈsoi̯soi̯/ n.I (ipsoi « eau »)
eau fraîche ; giclée d’eau - soṅaiṅai /soˈŋai̯ŋai̯/ n.E (tsōṅkai « ours »)
nounours ; ourson ; ours adulte (dans un contexte de tabouisation, par exemple pendant la chasse)