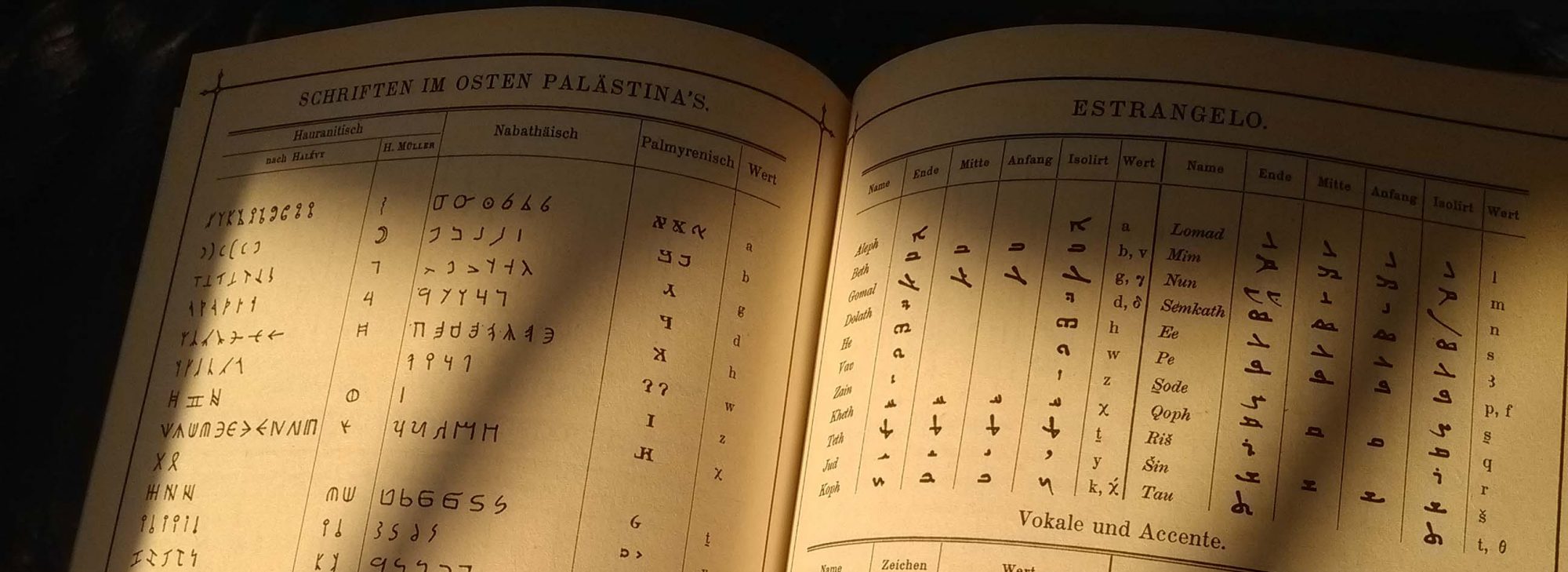gô-gweopp /goːˈgwɤ̆p/, nom
- ski(s)
Ce composé numéral, comme gô-kmâ il y a cinq jours, emploie gô « deux » pour désigner une paire, mais peut aussi désigner un seul de ses membres.
Le second élément est gweopp, nominalisation instrumentale du verbe « glisser » (antique *bibop) ; cependant gweopp n’est plus employé seul en tant nom pour le sens « luge, traîneau ». Pour mieux l’opposer à gô-gweopp, les locuteurices lui ont préfixé le numéral « un », pour obtenir gnâ-gweopp /gnaːˈgwɤ̆p/.

Par Unni Fürst / Norsk folkemuseum, CC BY-SA 4.0, Lien