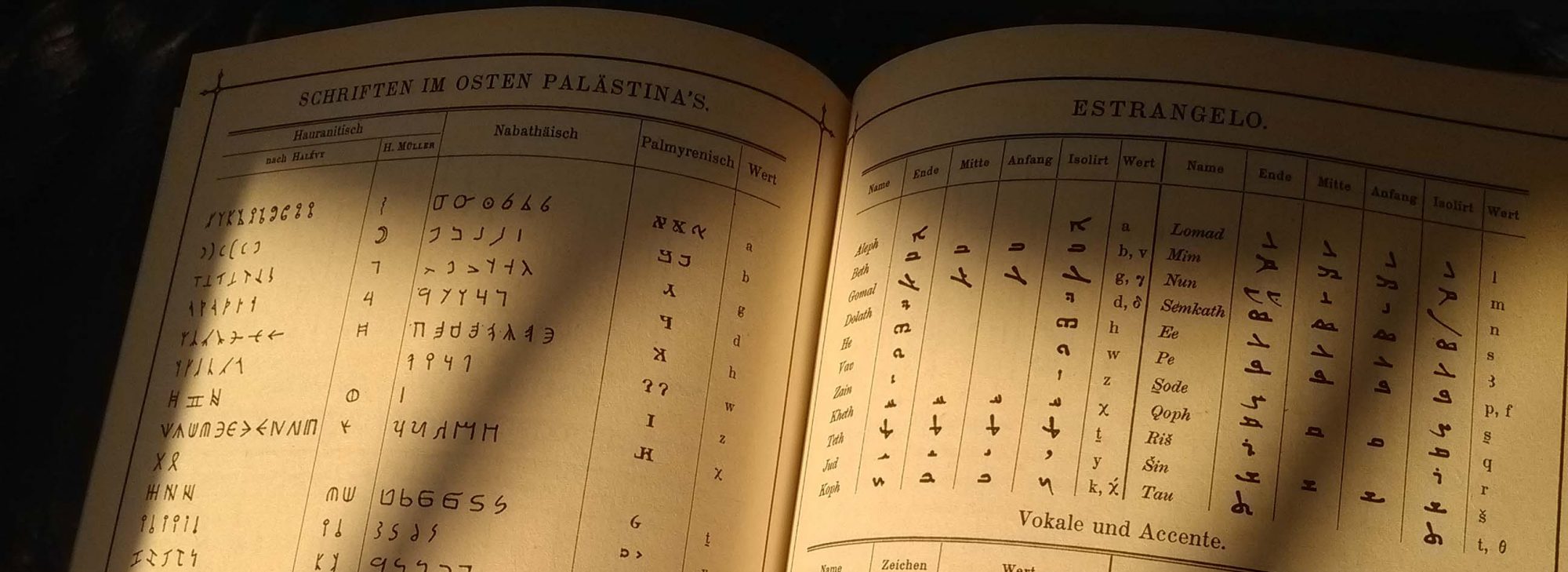Le dernier livre que j’ai lu est un essai sur le thème des langues construites, questionnant les liens entre la poésie (au sens large) et la création langagière (au sens large).
Comment des gens vont-ils s’approprier une langue artificielle jusqu’à y composer des vers ? C’est la question que se pose le poète autrichien Clemens J. Setz dans les 400 pages de ce livre.
Celui-ci débute avec un résumé de l’histoire du bliss, inventée par Charles Bliss (1897−1985) au milieu du siècle dernier. Cette langue consiste en un système modulaire de symboles conçus pour être les plus iconiques possible. C’est au Canada dans les années 70 que des éducateurs introduisent le bliss auprès d’enfants lourdement handicapés, incapables, en raison de la précision motrice requise, d’utiliser un quelconque langage oral ou gestuel. En pratique, cela consiste en une centaine de signes inscrit sur une tablette, que les enfants indiquent à la suite pour former des mots et des phrases plus complexes.
Cela faisant, ils peuvent enfin témoigner de leur vie intérieure que parents et éducateurs ne soupçonnaient pas, qui avaient tendance à les considérer comme des « légumes » puisque ne disposant pratiquement d’aucun moyen d’échange structuré avec le monde extérieur. Les témoignages, souvent poignants, que Setz a recueillis pour cette partie montrent bien ce contraste de l’avant et après introduction au bliss. Il s’est particulièrement intéressé au cas de Mustafa Ahmed Jama, Suédois d’origine somalienne, auteur d’un recueil de poèmes composés entièrement en bliss, qu’il considère comme sa langue maternelle.
Le chapitre Liber Pictorum présente un poème singulier de H.C. Artmann (1921−2000), « Versuch einer kleinen Chrestomathie mit Zisternen », présenté par ce dernier comme une histoire picte. Or les Pictes, peuple écossais de l’Antiquité, ne nous ont laissés presque aucune trace écrite, au point que nous ne sommes toujours pas sûrs quelle sorte de langue exactement ils parlaient. Une langue celtique ? Ou d’une autre branche indo-européenne ? Ou un isolat ? Hol hen amassar am ttarffon crimm, ni:hoel littam… Ce qu’a écrit Artmann ressemble à un mélange de gaélique et de gallois ; mais ce n’est ni l’un ni l’autre.
On découvre ensuite des extraits du journal intime de Clemens J. Setz, datant d’une période difficile de sa vie coïncidant avec son apprentissage du volapük. Le volapük est la première langue auxiliaire ayant bénéficié d’une large couverture médiatique mondiale, à la fin du dix-neuvième siècle, avant de sombrer dans un relatif oubli au bout de dix ans à peine. Durant les extraits, Setz tente d’exprimer son ressenti avec des mots volapük, y compose des poèmes ; à côté de cela, on découvre l’histoire d’autres auteurs ayant cherché à trouver du sens au-delà des langues existantes, comme : l’écrivain de SF Samuel Delany qui en fit le thème de son célèbre roman Babel-17 ; la linguiste Suzette H. Elgin (1937−2015) qui créa la langue « intrinsèquement féministe » láadan ; James Keilty, l’idéolinguiste qui à force de détermination réussit à faire jouer des pièces de théâtre dans la langue de Prashad, son pays imaginaire ; Robert Ben Madison, qui lui instantia sa langue et son pays imaginaire dans la réalité sous la forme de la micronation Talossa.
Mais toute expression linguistique n’est pas forcément porteuse de sens, même quand elle est superficiellement identique à des énoncés en langues naturelles. Clemens J. Setz consacre un chapitre au grommelot, charabia employé par les comédiens de théâtre qui peut être fléchi de manière à ressembler à une langue déterminée grâce à ses intonations, ses phonèmes, son rythme, mais sans intention de cohérence ou de sens. Il rapporte le cas étrange d’un grommelot en langue des signes en 2013 à Soweto, lors des funérailles de Nelson Mandela. Pendant quatre heures, sur la tribune officielle, un homme un peu perdu gesticula dans ce qui ressemblait de la manière la plus superficielle possible à une interprétation en langue des signes des discours de personnalités. Ce fut un énorme scandale, surtout au sein de la communauté mondiale des Sourds effarée de se voir ainsi moquée.
Dans un registre plus positif, l’ancienne clinique psychiatrique Gugging près de Vienne, fondée par le docteur Navratil, compta parmi ses patients plusieurs poètes réinventant l’allemand dans leurs écrits :
August Walla (1936−2001), Edmund Mach, et Ernst Herbeck, ce dernier considéré par Setz comme un des meilleurs poètes en langue allemande du XXe siècle. Enfin, le dernier degré de la poésie sans le moindre sens —manifeste ou inconscient— est atteint avec Arli, le chien d’Elisabeth Mann Borgese, à qui elle avait « enseigné » la machine à écrire. On peut tenter de reconnaître des fragments de mots dans ses lignes, mais il est douteux que le chien ait jamais compris la relation entre signifiant et signifié.
La dernière partie de l’essai a l’espéranto en arrière-plan, cette langue à vocation auxiliaire internationale qu’on ne présente plus. Plutôt que de récapituler encore une fois les étapes de sa création et de son développement, Setz préfère présenter la vie extraordinaire du poète espérantiste d’origine russe Vassili Erochenko (1890−1952). Devenu aveugle très tôt dans sa vie, il obtient, grâce à son accès au réseau international formé par l’espéranto, la possibilité de voyager en Europe, au Japon, en Chine, en Asie du sud-est. Polyglotte génial, il recueille et compose des poèmes et des fables dans les langues de tous les pays qu’il découvre en plus de l’espéranto. Homme engagé, il met son talent au service des associations socialistes, à l’époque assez proches de la langue internationale. Cela n’a pas été sans lui causer quelques problèmes avec les autorités. En générale, les dictatures des années 30 furent assez méfiantes vis-à-vis des projets internationalistes, que ce soit en Allemagne nazie, dans le Japon impérial ou en Union soviétique.
Die Bienen und das Unsichtbare se distingue d’autres livres de ma bibliothèque en ceci qu’il ne s’agit pas là d’exposer une méthode de création de langue, ou de théoriser le pourquoi de cette construction, ou d’esquisser une histoire de l’idéolinguistique. À travers les nombreuses anecdotes qui émaillent le livre, l’auteur nous dévoile des facettes de l’idéocréation plus intimistes, liées plus fermement à des destins particuliers. Son style frais et direct rend la lecture agréable, même lorsqu’on est comme moi peu perméable à la poésie.